Quatrième de couverture :

Quoi de plus public qu’un banc public ? Seulement aux yeux d’Auguste, 85 ans, ce banc, c’est « son » banc, ou plutôt celui de sa femme, qui aimait tant ce parc du Vésinet. Chaque jour, le veuf vient y ruminer sa solitude, ses rapports avec une belle-fille sans gêne, un horizon tout tracé en maison de retraite…
Ce jour-là pourtant, il y a quelqu’un d’autre au bout du banc : Philomène, 15 ans, qui vient de perdre sa mère et cherche quelqu’un à qui parler. Lui, l’hiver. Elle, le printemps. Bientôt, tous deux s’apprivoisent et concoctent un projet. Partir. Fuguer. Et dans ce périple improvisé, trouver, peut-être, un sens à la vie…
Critiques presse :
« Émouvante, lumineuse, délicate, profondément humaine, cette histoire raconte le lien formidable qui se crée entre Auguste, 85 ans, et Philomène, 15 ans. Leur quête commune, inattendue, leur apportera à chacun un précieux cadeau. » Le journal de Quebec
« Claire Norton nous livre un roman lumineux et plein d’espoir, la rencontre entre deux personnages inoubliables portés par la plume sensible d’une auteure qui bouleverse à chaque fois» 20 Minutes
L'auteur : Claire NORTON

Nationalité : France, née le : 23/05/1970
Claire Norton est une romancière. Elle s’est inspirée de rencontres marquantes faites en milieu hospitalier pour l’écriture de son premier roman publié, « En ton âme et conscience » (Éditions Scripta Manent, 2015). « Malgré nous… » (2019), son deuxième roman, est aussi captivant que profond où s’entrecroisent magistralement les thèmes de l’amour et de l’amitié. Une histoire qui fait naître de très fortes émotions. En 2020, paraît « Ces petits riens qui nous animent ». Mère de trois enfants, elle concilie son activité professionnelle de directrice des ressources humaines avec sa passion pour l’écriture.
Mon avis :
Auguste, 85 ans, a « son » banc, dans un joli parc du Vésinet, un banc où il est venu tant s’asseoir avec son épouse Jeanne, un banc qu’il continue à fréquenter chaque jour. Auguste se sent seul, son fidèle compagnon, son chien Bounty est mort, les relations avec son fils sont superficielles, sa belle-fille n’est pas surnommée Cruella pour rien. Un jour Auguste apprend qu’il est atteint d’un cancer incurable qui ne lui laisse que quelques mois à vivre, il garde ce secret pour lui seul, et il a entendu une conversation entre son fils et sa belle-fille qui s’apprêtent à le placer dans une maison de repos.
Un jour est assise sur son banc, une toute jeune fille tout aussi désemparée que lui, elle a 15 ans, sa mère est décédée depuis peu dans un accident de voiture. Elle veut à tout prix connaître la vérité sur la cause de l’accident, suicide ? Tout naturellement le contact s’établit entre ce vieux monsieur de 85 ans et cette gamine de 15 ans, l’un envisage un suicide assisté et a entrepris les démarches en ce sens en Suisse mais avant il veut retrouver un ami d’enfance avec lequel il s’était fâché, elle veut retourner sur les lieux de l’accident pour découvrir la vérité . Contre toute attente ils décident de fuguer ensemble.
Claire Norton brode là dessus un roman empreint de sentiments et d’humanité mais qui m’est apparu quelque peu invraisemblable. Autour de nos 2 héros viennent se greffer des personnages secondaires qui apparaissent dans des circonstances de hasard qui arrangent bien les choses. Le roman flirte avec le mélo et l’eau de rose, cependant les thèmes abordés, euthanasie, suicide, deuil le sont avec beaucoup de sensibilité, reconnaissons à l’autrice ce sérieux dans le récit. J’ai trouvé que les émotions passaient mal, sauf dans les 50 dernières pages, sans doute un style un peu fade et trop fluide. Quand on dit qu’une personne est gentille c’est qu’on ne lui trouve pas d’autres qualités, c’est ce que je ressens de ce roman, c’est un gentil roman ce qui n’est pas déjà si mal par les temps qui courent mais qui me laisse sur une impression mitigée.
Extrait :
«Ce n’est pas le processus de vieillissement qui fait mal. On ne s’en rend souvent pas compte car il se faufile insidieusement dans le quotidien. On le décèle parfois au détour d’une ride d’expression qui s’est creusée, par le biais de gestes simples que l’on ne fait plus avec la même facilité, ou lorsque l’on perd progressivement tout ceux qu’on aime… Non, ce qui est moche, ce n’est pas de vieillir mais de faire un jour le constat que l’on est devenu vieux. Et ça on le découvre subitement, parfois dans le regard des autres, souvent au travers de petites choses qui prennent une tout autre dimension au fil du temps : un voyage trop long, une charge trop lourde, des escaliers trop hauts, une nourriture trop épicée, des soirées trop tardives…D’un seul coup on réalise que, même si l’âge de nos artères n’est pas celui que l’on a toujours dans notre tête et dans notre cœur, on a basculé dans la catégorie des vieux. Et cet écart entre ce que l’on est et ce que l’on croyait être encore est extrêmement douloureux. »
En marge du roman : En Suisse, le suicide assisté est autorisé depuis 1942
La législation suisse autorise l’assistance au suicide, à la seule condition qu’elle ne réponde à un « mobile égoïste ». Aucune autre condition n’est posée par la loi. Mais les associations, qui accompagnent ces suicides, ont posé des jalons. Les soignants, eux, sont peu impliqués.

La question est posée abruptement par le coprésident d’Exit ADMD, Jean-Jacques Bise, à Agathe, 76 ans, atteinte d’Alzheimer : « Avez-vous bien demandé à un proche de vous avertir quand vous perdrez votre discernement ? Car après, il sera trop tard. » Agathe a demandé il y a trois ans à recourir au suicide assisté à Genève, en Suisse. Elle a fait la démarche « le lendemain du diagnostic », explique, dans les sobres locaux de l’association, cette femme apprêtée, rouge à lèvres carmin, colliers de perles et bagues aux doigts, et encore totalement autonome, même si elle cherche parfois ses mots et soudain s’impatiente. Son dossier est prêt et validé. Mais, le jour J, elle devra encore disposer de toute sa lucidité.

Le discernement et la capacité à s’administrer soi-même le liquide létal, prescrit par un médecin, sont les critères majeurs du suicide assisté. Une forme d’aide active à mourir débattue aujourd’hui en France et que la loi suisse autorise depuis quatre-vingts ans (1942). Plutôt, elle ne l’interdit pas, à une condition : la personne qui accompagne celui qui veut mourir ne doit pas être animée par un « mobile égoïste ». Comme l’espoir d’un héritage par exemple.
« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire », dit l’article 115 du Code pénal. L’euthanasie, elle, est interdite par l’article 114 du Code pénal. Un sujet qui « n’est jamais revenu dans les débats ».

Les autres conditions, ce n’est pas la loi qui les a posées, mais les cinq associations qui, dans la plupart des cas, se chargent d’accompagner les malades jusqu’au dernier instant. Les premières ont été créées en 1982. Piliers dans ce pays à la législation très libérale, elles ont elles-mêmes posé des jalons. Des « garde-fous », dit Jean-Jacques Bise.
Il faut notamment un dossier médical validé par un médecin. La personne doit être atteinte d’une maladie incurable, en fin de vie, avec de grandes souffrances. Un cancer en phase terminal. Une maladie dégénérative. Ou, depuis plus récemment, des polypathologies invalidantes liées à l’âge. Un large spectre. Les maladies psychiques, rares, ne sont pas exclues. « Nous n’aidons que des gens qui ont des raisons médicales de demander notre aide », insiste le vice-président.
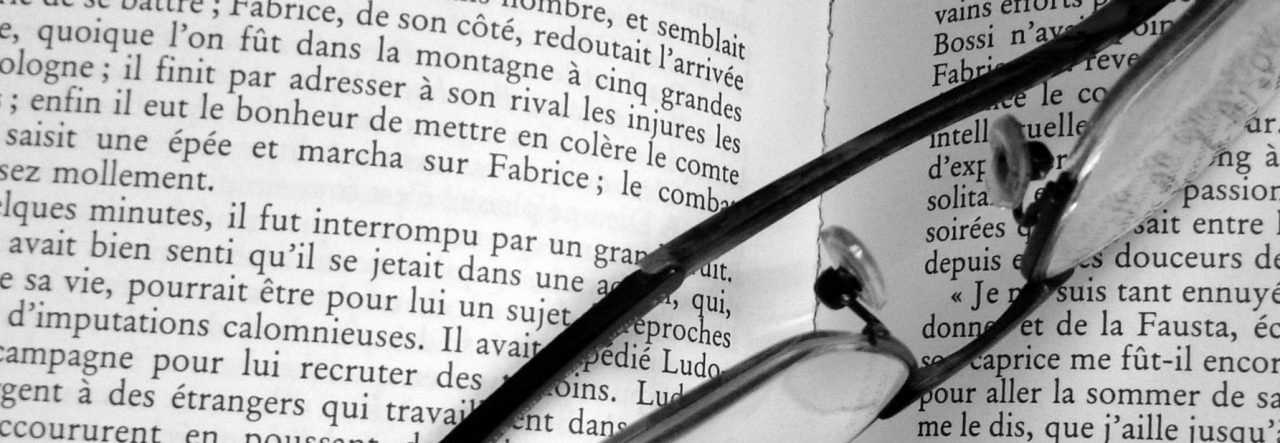







 Dans sa maison de la Grande Plaine, Mme Szöcs attend qu’on vienne la chercher: son mari est en train de mourir. A l’hôpital, Vince ne la reconnaît pas, et sa dernière phrase est destinée à Iza, leur fille trop aimée. Une fois son père enterré, Iza emmène sa mère vivre avec elle dans on appartement de Budapest. Elle a tout décidé, fait le tri entre meubles et objets à garder et à abandonner, arrangé la chambre, sans demander à la vieille dame -qui pourra « enfin se reposer » -ni son avis ni ses envies. Peu à peu la fragile vieille dame se pétrifie de la non-existence qui lui est ainsi offerte, jusqu’au jour où elle décide de retourner dans son village…
Dans sa maison de la Grande Plaine, Mme Szöcs attend qu’on vienne la chercher: son mari est en train de mourir. A l’hôpital, Vince ne la reconnaît pas, et sa dernière phrase est destinée à Iza, leur fille trop aimée. Une fois son père enterré, Iza emmène sa mère vivre avec elle dans on appartement de Budapest. Elle a tout décidé, fait le tri entre meubles et objets à garder et à abandonner, arrangé la chambre, sans demander à la vieille dame -qui pourra « enfin se reposer » -ni son avis ni ses envies. Peu à peu la fragile vieille dame se pétrifie de la non-existence qui lui est ainsi offerte, jusqu’au jour où elle décide de retourner dans son village…
 Le huis clos d’une mère et sa fille, par la révélation étrangère 2003, Magda Szabo.
Le huis clos d’une mère et sa fille, par la révélation étrangère 2003, Magda Szabo.
